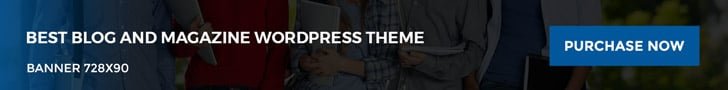« Haya bwana, chakula kisipotee » qu’on ne laisse pas la nourriture se perdre ».
C’est par cette phrase, glissée à l’oreille d’une cousine, que commence notre après-midi d’enquête dans un mariage à Katindo. Les youyous couvrent un instant la musique, les femmes en pagnes impeccables se pressent autour des plats.
À Goma, lors des cérémonies, il est devenu courant que des invités repartent avec de la nourriture dans des seaux, sachets ou boîtes — on appelle ça kushana.
Pratique banale pour certains, embarrassante pour d’autres, le kushana divise. Pourquoi le fait-on ? Est-ce seulement la pauvreté ? Et surtout, est-ce une bonne chose pour nos mariages ?
Nous avons sillonné plusieurs quartiers (Mabanga, Katindo, Ndosho, Keshero) et recueilli des témoignages, majoritairement de femmes, pour comprendre ce qui se joue derrière les plats qui s’en vont.
« On a faim, on pense aux enfants » Voix des femmes
Claudine, 32 ans,
vendeuse de beignets, mère de trois enfants (Mabanga Sud)
Elle serre un petit seau bleu, rangé sous la table.
« Mwanangu, je ne viens pas voler. J’ai été invitée, j’ai dansé, j’ai contribué au likabu. Quand je vois beaucoup de nourriture, je pense aux enfants qui m’attendent. Kushana me rassure : demain matin, ils mangeront. »
Jeannette, 24 ans, étudiante à l’UCG
> « On sait que ce n’est pas élégant d’emporter sans demander, mais la réalité mord. Les prix montent, le kivuruga [brouillard] économique est là. Parfois, je prépare une petite boîte dans mon sac, juste au cas où. »
Maman Sifa, 48 ans, tante de la mariée (Keshero)
« À notre époque, on servait et on redistribuait à la fin, proprement. Aujourd’hui, certains arrachent les plats avant même les mariés.
Ça humilie la famille. Kushana doit se faire kwa heshima [avec respect] — sinon, c’est la honte. »
*Aline, 29 ans, traiteur·e (Ndosho)*
> « Le problème commence à la logistique. Les hôtes ne calculent pas toujours les portions. Quand il y a bousculade, les gens s’énervent, wanachukua tu [ils prennent juste]. Nous, on recommande des tickets repas, des files, et une redistribution officielle des restes. »
Deux voix d’hommes… en minorité
Eric, 27 ans, motard (Goma ville)
« Je comprends le kushana. Tu ne peux pas avoir mangé ici et laisser tes petits frères sans rien. Mais il faut des règles. Sinon, ça devient un marché. »
Le pasteur M., 51 ans
> « La fête célèbre l’union et le partage, pas la démesure ni la confusion. On peut organiser une table de charité à la fin, bénir les paniers, et distribuer dignement. »
Pourquoi kushana s’est imposé : entre économie, insécurité et habitudes
Pression économique durable.
L’Est de la RDC traverse une crise humanitaire majeure, avec des déplacements massifs et une insécurité alimentaire qui s’aggrave. En 2025, le PAM indique viser 6,4 millions de personnes d’assistance dans le pays et signale une hausse des besoins liée aux conflits et aux prix alimentaires.
Cela renforce les comportements de sécurisation de la nourriture au niveau des ménages.
Déplacements et précarité à l’Est.
Les provinces du Kivu comptent des millions de personnes déplacées internes, mettant une pression sur les familles d’accueil et les budgets des foyers — la nourriture « à emporter » devient une stratégie de survie de plus.
Culture du partage… mais qui dérape. Dans nos traditions, la fête implique ukarimu (générosité) et kushirikiana (partage).
Le kushana en est pour certains une extension logique, mais sans cadre, il glisse vers la bousculade, la frustration et l’humiliation des hôtes.
Gestion des restes et risques sanitaires.
Emporter des plats encore chauds dans des sachets non adaptés, marcher longtemps sous le soleil, réchauffer plusieurs fois tout cela augmente les risques d’intoxication alimentaire.
L’OMS rappelle que 600 millions de personnes tombent malades chaque année à cause d’aliments dangereux et 420 000 en meurent, les enfants étant les plus touchés.
Ce que disent les témoins… quand ça se passe mal
Dora, 21 ans, cousine du marié
« On avait prévu des plats par table. Mais des invités se sont levés, ont rempli des bassines et sont partis. La mariée a pleuré : “Hata sisi hatujala” [même nous, on n’a pas mangé]. »
Aline, la traiteure
> « Quand les plats disparaissent, les équipes paniquent, la famille accuse le traiteur. Ça casse la fête, et ça coûte cher à tout le monde. »
Ce qu’on a observé sur le terrain (check-list rapide)
Des boîtes ou seaux dissimulés sous les kitenge.
Des go-bags (sachets) distribués par une amie « organisée ».
Des mamans qui négocient franchement avec le service : “Tupatie tuende, watoto wanasubiri” [donnez-nous à emporter, les enfants attendent].
À l’inverse, des hôtes qui prévoient déjà des paniers solidaires pour les voisins non invités ou les déplacés du quartier.
*Pourquoi nous pensons que le kushana « au désordre » n’est pas bon*
1. Il abîme la dignité des mariés. Être privé soi-même de repas à sa propre fête, c’est une blessure.
2. Il met en danger la santé. Transport et conservation aléatoires → risques d’intoxication (surtout pour les enfants).
3. Il creuse les tensions familiales. Accusations, soupçons, factures qui explosent… la fête finit en querelle.
4. Il banalise le manque de cadre. L’hospitalité n’exclut pas l’organisation.
Des solutions concrètes, locales et réalistes
Invitations claires + tickets repas. Chaque invité reçoit un ticket pour le service principal. Les « extras » sont servis plus tard, calmement.
File unique + service par table. Évite la bousculade, réduit la tentation de kushana « sauvage ».
Table officielle des restes (15–30 min avant la fin). Annonce au micro : « Redistribution ouverte ». On remet des portions à emporter dans des contenants propres (boîtes/foil) par le staff.
Paniers solidaires. Prévoir d’emblée 10–15 % du budget nourriture pour des paniers remis à des mamans du voisinage ou des sites de déplacés proches.
Coordination avec un relais communautaire pour la distribution. (Le contexte humanitaire local justifie ce geste structuré.)
Règles d’hygiène simples. Refroidir rapidement, emballer hermétique, marquer la date/heure, éviter de laisser les plats des heures en plein air. (Rappels conformes aux lignes OMS.)
Brief des maîtres de cérémonie (MC). Script clair : expliquer le déroulé des services, rappeler que ukarimu ≠ désordre.
Budget transparent côté hôtes. Affiner les quantités (traiteur), calibrer les portions, prévoir une équipe « sécurité douce » pour canaliser.
Faut-il interdire kushana ? Notre position
Interdire n’aurait pas de sens dans un contexte où la précarité pousse à sécuriser la nourriture. Mais organiser le partage, oui : pour protéger la dignité des mariés, la santé des invités et l’image de nos fêtes.
L’hospitalité gomatracienne est une force ; donnons-lui un cadre pour qu’elle reste belle.
Encadré Chiffres clés qui expliquent le contexte
Le PAM annonce, en 2025, une montée des besoins et un objectif d’assistance à 6,4 millions de personnes en RDC face au conflit et à la cherté de la vie.
À l’Est, des millions de déplacés internes accentuent la pression sur les ménages hôtes et les ressources familiales.
Les maladies d’origine alimentaire touchent 600 millions de personnes chaque année dans le monde ; les enfants sont particulièrement vulnérables.
Conclusion
Le kushana à Goma n’est pas qu’une « mauvaise habitude » : c’est le symptôme d’un paysage économique et social sous tension, où la solidarité se mêle parfois au désordre.
En tant que communauté, nous pouvons garder l’esprit du partage tout en installant des règles simples pour que la fête demeure fête kwa heshima na furaha (avec respect et joie).
Pour Zionnews-tv.net / Jason Kabera